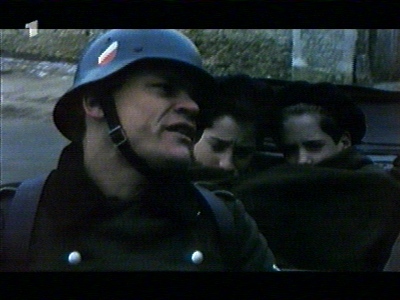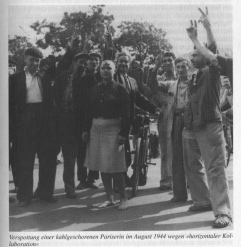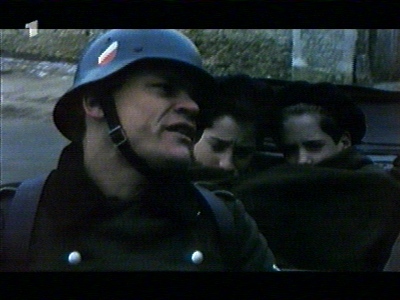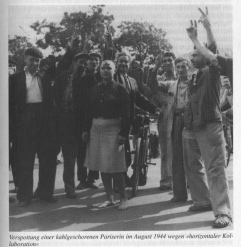Louis Malle, « Lacombe Lucien
» en comparaison avec Louis Malle, « Au revoir les enfants
»
Facharbeit
im Fach Französisch
am
Stadtgymnasium Köln-Porz
vorgelegt von
Gereon Schüller
Köln, Februar 2001
Préface
Nous vivons à une époque où la xénophobie et
l'antisémitisme sont toujours actuels. Louis Malle, un des réalisateurs
les plus importants de la vingtième siècle, montre dans deux
de ses films la situation française sous l'occupation allemande.
Avec ces films, il dessine les destins de deux personnes.
Cette « Facharbeit » doit montrer les différences
et ressemblances de ces histoires-ci.
Elle analyse les situations dans lesquelles les caractères analogues
se trouvent.
J'espère qu'elle aide à comprendre les deux films et
les sentiments que l'auteur - qui vivait dans cette époque - veut
exprimer.
C'est pourquoi j'ai aussi pris des commentaires qu'il a dites sur son
travail.
Pour comprendre les circonstances historiques j'ai essayé d'extraire
les passages les plus frappants du livre incendiaire « Juif ou Français
», publié par le gouvernement Vichy en 1942.
Je sais qu'il faut être très sensible si on prend un texte
tellement raciste comme ce livre.
Mais je pense qu'il faut aussi comprendre les tendances françaises
à cette époque-là.
La majorité du livre est inutile parce qu'il ne consiste que
des accusations contre les juifs, mais je pense qu'il y en a des passages
qui montrent l'attitude envers les juifs.
Table de matières
Préface
Table de matières
Introduction
Lacombe Lucien
Résumé du
contenu
Les personnages principaux
Lucien
Jean-Bernard
La famille Horn
Au revoir les enfants
Résumé du
contenu
Les personnages principaux
Julien
Bonnet
Joseph
Comparaison des textes
Peut-on comparer les deux
films?
Le rôle de l'occupation
les Allemands
les Collaborateurs
La résistance
Le contexte historique
Comparaison de personnages
analogues
Lucien-Joseph
Bonnet-Horn
Peyssac-Père Jean
Le reflet des expériences
de l'auteur
Conclusion
Annexe
Remarques
Bibliographie
Images
Introduction
Louis Malle qui est mort en 1995 a fait deux films sur l'occupation. Entre
les deux films, il y a un intervalle de 16 ans. Qu'est-ce que Malle a changé
dans le deuxième film ? Pourquoi a-t-il choisi de faire deux films,
pourquoi était-ce nécessaire ?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire
de connaître les deux films. On ne peut pas attendre que tout le
monde connaisse les films. C'est pourquoi cette « Facharbeit »
consiste de trois parties :
-
Présentation de « Lacombe Lucien »
-
Présentation de « Au revoir les enfants »
-
La comparaison
Bien sûr, on ne peut pas isoler les films de leur contexte historique.
Une partie subordonnée décrit le contexte à l'aide
d'un livre qui traite de l'occupation. Aussi, on y trouve un extrait du
livre « Juif ou Français », publié en 1942. J'espère
que l'extrait fait comprendre l'attitude française.
Je pense que la comparaison aide à comprendre le progrès
de l'auteur et sa motivation que je montre aussi dans la partie «
Le reflet des expériences de l'auteur ».
Dans l'annexe on trouve des images des deux films et de l'occupation.
Lacombe Lucien
Résumé
du contenu
L'action se déroule pendant la deuxième guerre mondiale sous
l'occupation allemande. Le film traite d'un garçon qui s'appelle
Lucien Lacombe, domestique dans un hospice. Quand il rentre à son
village, il parle avec Peyssac, son vieux professeur qui est dans la résistance.
Il lui demande s'il peut entrer au maquis. Mais Peyssac le refuse.
Après cette réponse, il décide d'aller en ville.
Quand il fait nuit, il est découvert par un agent de la police allemande.
On l'interroge dans un hôtel et lui donne de l'alcool. Il dénonce
Peyssac.
Il commence à travailler avec la police allemande. Le chef,
Jean-Bernard, va avec lui chez un tailleur juif, M. Horn, qui doit tailler
un costume pour Lucien.
Avec Jean-Bernard, il arrête un membre de la résistance
avec sa famille.
Cinq jours après, Lucien emporte son costume. Il rencontre la
fille d'Horn, France. Le soir, il apporte des bouteilles du champagne pour
France. Horn dit à sa fille et sa femme de boire mais la mère
ne veut pas en boire. La relation avec France devient de plus en plus importante.
Il la ramène à l'Hôtel Des Grottes où la police
allemande travaille. Ils dansent et France boit beaucoup. Le matin, France
et Lucien se trouvent dans le même lit.
Jean-Bernard et son amie Betty s'enfuient en voiture pour l'Espagne.
Dans l'après-midi, Lucien trouve les deux dans le bas-côté,
abattus à la mitraillette.
La mère de Lucien le visite chez les Horn. Elle lui dit qu'elle
a reçu un cercueil, ça veut dire la résistance veut
assassiner Lucien.
Peu après, Horn arrive à l'Hôtel Des Grottes pour
visiter Lucien. Quand Faure, un autre policier le voit, il alarme la «
Kommandantur ». On l'emmène.
Lucien trouve un prisonnier qui lui offre de venir avec lui, mais il
ne veut pas. Quand il descend, il voit que le maquis a tué tous
ses collègues.
Lucien se dirige vers la maison des Horn pour les sauver. Mais la SS
est déjà là. Lucien tue un Allemand et s'en va avec
France et la mère.
Il trouve une maison vide et s'y installe. Il y passe un dernier temps
heureux.
À la fin du film, on apprend que la résistance l'a condamné
à mort et exécuté.
Les personnages principaux
Les citations suivantes se réfèrent à « Lacombe
Lucien », indiqué dans la Bibliographie.
Lucien
Il fait un travail inférieur, sa mère vit avec un autre homme,
pendant que son père est en prison. Il ne sait pas quoi faire, on
peut dire qu'il s'ennuie.
Alors, il décide de travailler dans la résistance. Mais
son professeur Peyssac ne veut pas travailler avec lui.
Par hasard, il aperçoit l'Hôtel des Grottes et aide la
police.
Alors, ça veut dire qu'il n'aide pas les Allemands mais cherche
plutôt un passe-temps.
Quand il rencontre M. Horn, il trouve quelqu'un qui s'occupe un peu
de lui et qui ne veut rien de lui.
Mais ses émotions amoureuses sont plus fortes. Il tombe amoureux,
il veut posséder France. Quand il n'arrive pas à la gagner
en l'impressionnant (par exemple il l'aide à l'épicerie),
il utilise son pouvoir. Et elle ne peut pas non plus résister parce
qu'elle craint sa colère.
À cause de cette amour, il tue un soldat et sauve France et
sa mère. Il retourne à la nature, il chasse encore une fois.
Mais le sauvetage de France et sa mère ne peut pas le protéger
contre la résistance. Il est condamné à mort et exécuté.
Il trompe tout le monde : sa mère, la résistance, les
Allemands et M. Horn. Il tue sans réfléchir, il n'a pas de
respect, ni pour les animaux chassés ni pour les hommes.
Ces traits de caractère montrent qu'il est nihiliste. Il ne
croit pas à personne, il ne pense pas à l'avenir, il vit
sa vie sans égard pour les autres et ni pour lui-même.
Jean - Bernard
Il travaille pour les Allemands et il est redouté par la résistance.
Il arrête les membres de la résistance en utilisant des trucs,
par exemple il dit qu'il a une jambe malade pour convaincre le docteur.
Il utilise son pouvoir pour exploiter M. Horn. Il le protège
et Horn doit lui payer de l'argent et tailler gratuitement.
Mais il a aussi peur. Il se rend compte que la guerre est presque perdue,
que les alliés ont débarqués en Normandie ces jours.
Pour survivre la fin de la guerre, il décide d'aller avec Betty
en Espagne.
Il implique Lucien quoiqu'il sache que Lucien n'a pas de chance parce
que l'occupation allemande est presque finie.
Alors, on peut dire que Jean-Bernard est un collaborateur qui collabore
parce qu'il défend ses intérêts comme son amie Betty
qui collabore aussi parce qu'il veut être actrice à la Continental1.
Mais quand le deux décident de s'enfuir en Espagne, il sont
abattus par la résistance.
La famille Horn
M. Horn sait qu'il est cherché, il sait qu'il n'y a pas de chance
de survivre l'Holocauste.
Mais il essaie de se cacher. Pour gagner de la sécurité,
il donne de l'argent à Jean-Bernard et en plus il doit tailler.
Nous savons qu'il connaissait le père de Jean-Bernard (p. 52).
Il reste très gentil, même si la situation ne prête
pas à rester gentil. Quand Lucien le terrorise, il ne veut pas qu'il
quitte. Quand Lucien veut sa fille, il ne l'arrête pas. Mais il ne
peut plus endurer cette situation. Alors, il se jette dans «la gueule
du loup» pour être déporté.
Sa femme est différente. Elle n'a pas de confiance en les Allemands,
ni en collabos, c'est à dire qu'elle se méfie de Lucien.
Elle se trompe parce que c'est lui qui la sauve.
La fille est très différente de ses parents. Elle pense
que Lucien est son sauvetage, et elle a raison d'une certaine manière.
Elle ne veut plus être juive, elle veut être libre. Alors,
elle fait de la « collaboration horizontale » (Seidler, p.
23).
Dès les dernières scènes du film, on comprend
qu'elle partage avec Lucien l'affinité à la nature.
Au revoir les enfants
Résumé du contenu
Julien Quentin est élève d'un internat en Île-de-France
en 1944. Il part de Paris parce que les vacances de Noël sont terminées.
Quand il arrivé à l'internat, trois garçons nouveaux
entrent. Julien s'intéresse pour un de ces garçons qui s'appelle
Jean Bonnet. On apprend que Jean est meilleur élève que Julien
aux cours. Julien est déçu quand Jean dit que son meilleur
ami s'appelle Négus parce que Julien espère devenir son meilleur
ami.
Après, Julien va chez Joseph qui travaille à la cuisine
pour changer de la confiture contre timbres, une sorte de marché
noir.
Le soir, les autres élèves jouent un mauvais tour à
Bonnet.
Quand Julien confesse chez le Père Jean, le téléphone
sonne et on écoute un dialogue étrange.
Le jour prochain, les élèves vont aux bains-douches publiques.
Boulanger, un élève dit que les communistes sont plus dangereux
que les Allemands. Ils entrent dans la baignoire qui est interdite aux
juifs. Dans la baignoire, il y a des Allemands qui disent des choses gentilles
sur Bonnet.
Les miliciens perquisitionnent le collège parce qu'ils cherchent
un réfractaire. C'est le surveillant Moreau, mais il peut se cacher
dans les W.-C.
Dans le casier de Bonnet, Julien trouve un livre. Sur la première
page, on peut lire le surnom, mais le nom de famille a été
raturé. Sur la page opposée, Julien peut lire le nom «
Kippelstein ».
Au cours de grec, Bonnet n'écrit pas la dictée. Il dit
à Julien qu'il vient de Marseille et qu'il n'a pas appris le grec.
Il ne veut pas parler de sa mère et de son origine.
Les élèves jouent au foulard. Un groupe remarque que
Julien et Bonnet manquent. Ils se sont perdus dans la forêt. Il fait
nuit. Les deux marchent. Tout à coup, ils voient deux phares. C'est
une voiture. Quand ils voient que ce sont des soldats allemands, ils se
jettent dans les arbres, mais les soldats les rattrapent. Ils sont très
gentils. Ils les ramènent à l'internat. Un soldat dit qu'il
sait où l'internat est parce que les bavarois sont aussi catholiques.
Ils informent le Père Hippolyte que la forêt est interdite
aux civils après 20 heures.
À l'infirmerie, Julien offre de la tartine de pâté
à Bonnet. Mais celui-ci ne veut pas. Julien constate que Bonnet
ne veut pas en prendre parce que c'est du cochon et que Bonnet s'appelle
Kippelstein. Bonnet attaque Julien.
Le dimanche Julien, François, Bonnet et Mme Quentin mangent
dans un restaurant. Quand ils mangent, deux miliciens entrent et demandent
les papiers d'un monsieur qui est juif. Ils lui disent de quitter le restaurant,
mais un officier allemand se lève et dit aux miliciens de quitter.
En rentrant, les Quentin voient Joseph avec une fille.
Le soir, les élèves regardent un film de Charlie Chaplin.
Aussi le Père Jean rit. Le matin, Julien confesse à Bonnet
qu'il pisse au lit. Mme Perrin, la cuisinière attrape Joseph qui
veut voler du saindoux pour le vendre au marché noir. Joseph est
renvoyé. François et Julien qui ont fait du marché
noir avec Joseph sont privés de sortie jusqu'à Pâques.
En classe, le professeur donne des nouvelles de la guerre. En ce moment,
Doktor Muller de la Gestapo entre et veut savoir qui est Jean Kippelstein.
Un Feldgendarme tire Bonnet par le bras. Muller informe les élèves
qu'il faut faire ses bagages et se mettre en rang dans la cour. Moureau
arrive à s'enfuir mais la Gestapo prend le trois élève
juifs et le Père Jean. On apprend que Bonnet, Négus et Dupré
sont morts à Auschwitz et le Père Jean est mort à
Mauthausen.
Les personnages principaux
Les citations suivantes se réfèrent au scénario
du film « Au revoir Les Enfants », indiqué dans la Bibliographie.
Julien
Déjà au début du film, on apprend que Julien est un
garçon très doux. Il est difficile pour lui de se séparer
de sa mère. Il pleure à la gare. Même dans le train,
il pleure, et « Il y a de la douceur maintenant dans son expression
» (p.9).
Mais il ne faut pas oublier que Julien a seulement douze ans. On peut
conclure que Julien n'a pas une position très élevée
parmi les autres élèves parce que « Les élèves
se moquent de lui, mais le trouvent 'sympa'. » (p.11).
Quand Bonnet arrive, il commence directement à établir
une relation avec lui. Il s'intéresse aux livres de Bonnet.
Généralement, on peut dire que Julien s'intéresse
beaucoup aux personnes qui ne sont pas respectés par les autres.
Par exemple, il parle avec Joseph et fait avec lui du marché noir.
Les autres élèves embêtent Joseph (« Joseph est
à terre au milieu d'un groupe d'élèves qui se moquent
de lui et le font tomber chaque fois qu'il se relève », p.
66) et ils embêtent aussi Bonnet (« Bonnet se faire prendre
son biscuit par Sagard, qui le met dans sa bouche, le lèche, puis
le rend », p. 29).
Mais Julien ne fait pas ces jeux-là. On peut dire qu'il montre
une attitude sociale envers les élèves. Aussi le Père
Jean a reconnu cette qualité. Il lui demande d'aider Bonnet : «
Soyez très gentil avec lui. Vous avez de l'influence sur les autres.
Je compte sur vous. » (p. 45).
Cette qualité contribue peut-être à son désir
de devenir prêtre. Mais le Père Jean dit : « À
mon avis, vous n'avez aucune vocation pour la prêtrise. »
Alors, le Père Jean ne reconnaît pas les qualités
de Julien et sa vocation.
Julien est aussi très curieux. Par exemple, il ouvre le casier
de Bonnet et y trouve le livre avec le nom Kippelstein. Il veut aussi savoir
l'origine de Bonnet et n'en démord pas.
En plus, il est très intelligent. Par exemple, il reconnaît
que Bonnet ment quand il dit qu'il est né à Marseille et
que sa mère est en zone libre.
Enfin, il se rend compte que Bonnet est juif. C'est pourquoi il veut
savoir ce que c'est un « youpin », mais il apprend seulement
qu'un juif ne mange pas de cochon.
Quand il remarque que Bonnet ne mange pas de cochon, il conclut que
Bonnet est juif.
Bonnet
Il est nouveau à l'internat. Le Père Jean le cache parce
que Bonnet est juif. Il est un orphelin parce qu'il ne sait pas où
ses parents sont, peut-être déportés par les Allemands.
Alors, il doit affranchir des obstacles. Par exemple, les autres élèves
lui jouent un mauvais tour (p.29). Les autres élèves ne refoulent
pas, mais il ne s'occupent pas de lui.
Au début, il refuse l'amitié de Julien, il est timide.
Il hésite d'avoir une relation avec les autres élèves
parce qu'il a peur de se trahir. Il demande seulement à Bonnet «
Comment tu t'appelles ? » (p. 13). En classe on apprend que Bonnet
est très intelligent, il sait plus de choses que Julien. Le professeur
dit que Julien a « de la compétition » (p. 56).
La peur des Allemands est toujours présente. Quand un soldat
est dans la cour de l'internat pour se confesser, « Bonnet lève
les yeux brusquement. » (p.19). Dans les vestiaires des bains-douches,
il semble que la peur ait disparu. Mais elle n'a pas disparu comme nous
voyons dans la scène 29 : Deux Allemands gentils veulent rattraper
les deux garçons qui se sont trompés dans la forêt,
mais Bonnet essaye de s'enfuir.
De plus en plus, il a confiance en Julien. Il lui parle de sa mère
et n'arrive plus à mentir. Bonnet commence aussi à aider
Julien. Quand Sagard remarque que Julien urine au lit, il le défend
: « Bonnet est à ses côtés, deux contre tous
les autres ».
Même à cette époque dangereuse, Bonnet reste religieux.
Une nuit, il met débout deux bougies et commence à prier
(p.52).
Quand même, personne (sauf Julien) ne remarque pas qu'il est
juif.
À mon avis, il est très dangereux que le Père
Jean ne lui donne pas la communion (p. 82), mais les autres pensent probablement
qu'il est protestant comme il l'a dit aux bains-douches.
Quand il est dénoncé, il sait ce qui va se passer. C'est
pourquoi il donne ses livres à Bonnet.
Joseph
Joseph, qui travaille à la cuisine de l'internat, est « malingre
» parce qu'il a « une jambe plus courte que l'autre »
(p.25). C'est pourquoi il n'est pas obligé de faire du service obligatoire
en Allemagne, mais il a trouvé du travail à l'internat.
Comme Bonnet, il est en marge de la société. Les élèves
l'embêtent (p. 66), mais ils font du marché noir avec lui.
Mais les élèves le trompent : on ne lui donne pas l'argent
promis (p. 25). Seulement Julien s'occupe de lui ; il parle avec lui et
ne l'entraîne pas. Quand Joseph dit qu'il ne veut plus faire des
« affaires » avec les autres (p. 26), Julien lui dit qu'il
a de la confiture. Joseph n'arrive pas à se retirer du marché.
Peut-être a-t-il besoin de cet argent, mais on peut aussi dire
que le marché est son seul divertissement.
Ici, il est supérieur, il a des choses que les autres veulent
avoir, il n'est pas dépendant.
Dans l'amour il n'a pas de chance. Sa petite amie le quitte.
Quand il est attrapé par Mme Perrin, il dit que c'est elle qui
vole (p. 100), mais le Père Jean ne fait rien. Elle but au travail,
mais on ne la punit pas. C'est pour cette raison que Joseph trahit les
autres élèves du marché noir. Peut-être pense-t-il
qu'il peut se sauver, mais le Père Jean impose seulement une punition
légère à ces élèves. Quoique le Père
sache qu'il commet une injustice, il ne peut pas punir les élèves
parce que les parents protesteraient. Il pense qu'il ne faut pas craindre
la vengeance de Joseph. Il se trompe.
Une fois, Joseph veut avoir du pouvoir, il veut montrer qu'il est aussi
important que les autres.
À mon avis, il ne sait pas qu'il est responsable pour la mort
du Père Jean. Son intelligence ne suffirait pas pour se défendre,
et elle ne suffit pas non plus à reconnaître les conséquences
de son acte.
Au contraire, il pense qu'il a aidé les autres élèves
: « T'es content ? Tu vas avoir des vacances. » (p. 118).
Peu après, il blame sa faute sur Julien, il dit que c'est la
faute des autres parce qu'ils ont fait des affaires avec lui.
Alors, L. Malle nous montre que la dénonciation est faite par
un homme peu intelligent, ni capable de calculer les conséquences
et qui se venge d'une manière irresponsable.
Enfin, on peut dire que Joseph et le Père Jean sont des coupables
et des victimes.
Cela montre qu'il y a toujours deux façons des ragarder la vérité
: les « victimes » et les « bourreaux », comme
le Père Jean dit (p. 82).
Comparaison des textes
Peut-on comparer les deux films ?
Louis Malle a fait deux films très différents : l'un traite
d'un garçon jeune dans la police allemande, l'autre a pour sujet
un garçon qui est élève à un internat. Comment
comparer ces films ?
Premièrement, il est important que les deux films jouent dans
la même année, en 1944, sous l'occupation allemande en France.
Bien sûr, on pourrait dire que Lacombe Lucien veut montrer
« le couple impossible » comme Gertrud Koch écrit (Peter
W. Jansen, p. 96), mais il y a d'autres aspects.
Le même si on dit que Louis Malle avait des raisons différentes
pour réaliser les films, il faut penser aux émotions de l'auteur.
Celui-ci vivait sous l'occupation et il était lui-même à
un internat comme Julien. À cause de cela, il a des souvenirs qu'il
exprime dans tous les deux films. Ce qui se révèle, dans
ses scénarios, c'est toujours l'expression de son intérieur.
On voit des parallèles aussi dans l'extérieur. Par exemple,
dans le scénario de Lacombe Lucien comme dans Au revoir
les enfants, il y a des personnages qui portent les mêmes noms
: Hippolyte, Joseph, M. Muller.
Ça veut dire que Malle a certaines mémoires quand il
entend ces noms. Le nom Muller par exemple est - pour un Français
- symbolique pour un Allemand, peut-être.
Alors, si on demande si on peut comparer les films, je dis que oui.
Dans tous les deux, Malle exprime ses émotions, ses mémoires
au passé, s'il le veut par exprès ou non.
C'est pourquoi dans les paragraphes suivants, on trouve cette comparaison.
Le rôle de l'occupation
les Allemands
Malle nous présente une impression différenciée des
Allemands. D'un côté, il y a les Allemands brutaux, marionnettes
du système. Ils enlèvent Bonnet et le Père Jean, il
donnent des ordres. M. Muller de la Gestapo par exemple ne traite pas Bonnet
comme un homme, en vérité, il traite les élèves
et le Père comme des animaux.
Cette image-là est l'idée quotidienne d'un « boche
».
Mais il y en a aussi d'autres. Le soldat qui veut enlever les Horn
: il a ses ordres, et aide seulement. Mais il est assassiné, tiré
à la mitraillette par Lucien. Cet homme a collaboré - certainement
- mais il est aussi devenu une victime du système et du conflit
personnel de Lucien.
Les bavarois qui ramènent Julien et Bonnet sont vraiment très
gentils et un peu naïfs.
L'un est fier parce qu'il sait où l'internat est. Il dit que
les bavarois sont aussi catholiques. Ça montre qu'il reconnaît
des ressemblances entrent les Français et les Allemands. Il ne se
sent pas insulté quand il est intitulé « boche »,
au contraire il répète ce mot.
On nous montre qu'il y a aussi des opportunistes dans l'armée.
Le soldat ivre dans le restaurant qui dit aux miliciens de s'en aller utilise
son pouvoir pour épater Mme Quentin.
les Collaborateurs
Dans Au revoir les enfants, Louis Malle décrit deux collaborateurs
« officiels ». Ce sont les miliciens qui veulent faire M. Meyer
quitter le restaurant. Ils sont strictes, ils veulent qu'il quitte le restaurant
tout de suite. Ils ne veulent pas non plus suivre à l'Allemand et
disent à Meyer : « On se retrouva ! » (Au revoir
les enfants, p. 89). Quand François les insulte, ils disent
qu'ils sont « au service de la France ». Alors, ils sont d'accord
avec les idées des Nazis, ils pensent qu'ils aident la France.
L'attitude des collaborateurs dans le film Lacombe Lucien est
le contraire de cette attitude. Betty par exemple collabore parce qu'elle
veut travailler pour la Continentale. Elle dit :
« J'en ai assez, assez ! Il faut que je rentre à Paris
! Je dois voir Greven pour signer mon contrat avec la Continental !...
Tu entends? » (Lacombe Lucien, p. 31)
Mais d'après Seidler, ce n'était pas l'attitude populaire.
En effet, la majorité était d'accord avec les idées
fascistes, comme les miliciens dans le film Au revoir les enfants.
C'est peut-être un problème français - ou plutôt
européen - d'avouer que le peuple était d'accord avec le
national-socialisme. Mais Louis Malle a réussi à montrer
la situation française dans son deuxième film comme elle
était, sans préjugés, sans se taire.
La résistance
Normalement, la résistance est bonne, elle represente une époque
heroïque de la France
Mais Louis Malle ne représente pas cette attitude française
dans Lacombe Lucien. En effet, la résistance est responsable
pour que Lucien joigne les Allemands. À la fin du film, on apprend
que la résistance a exécuté Lacombe. Malle a souvent
reçu de la critique pour cela, mais c'est la vérité
que la résistance a tué des collabos. Seidler écrit
:
« Bereits während der
wilden Verfolgungen unmittelbar nach dem Abzug der deutschen Truppen kamen
10 519 Menschen zu Tode. Sie wurden ohne gerichtliches Verfahren erschlagen,
erschossen, erhängt und ertränkt. » (Seidler, p. 22 et
suivante)
(Déjà pendant les
persécutions sauvages aussitôt après le départ
des troupes allemands, 10519 hommes étaient morts. Ils étaient
assommés, fusillés, pendus et noyés sans procédure
judiciaire.) 2
Mais la résistance a été persécuté d'une
brutalité-inhumaine dans le film, parce que Jean-Bernard et Lucien
arrêtent M. Vaugeois, un médecin qui aide la résistance.
Dans son deuxième film, « Au revoir les enfants »,
il n'y a pas d'accusations contre la résistance. La résistance
cache les juifs, elle essaie d'aider à survivre, mais elle doit
payer - le Père Jean est mort à Mauthausen.
Il est intéressant que l'auteur trouve des raisons religieuses
pour la résistance : Dans son sermon, le Père dit : «
Mes enfants, nous vivons des temps de discorde et de haine... » (p.80)
Le contexte historique
Pendant l'occupation allemande, le gouvernement Vichy collaborait avec
les Allemands. En France, il y avait aussi de l'antisémitisme et
la persécution des juifs français. Pendant l'occupation,
un juif n'était pas regardé comme un Français, mais
comme un Juif. Dans un livre incendiaire publié en 1942, Gabriel
Malglaive écrivait :
« Veut-on démonter que
le Juif n'est pas Français, qu'il n'est pas Allemand ?... Le Juif
lui-même nous prouve surabondamment que pour vivre en France, il
n'en est pas moins Juif, que vivant en Allemagne ou en Chine, il n'est
ni Allemand ni Chinois ; il est reste un Juif. Rien qu'un Juif. »
(Malglaive, p. 31)
C'est pourquoi M. Muller de la Gestapo par exemple dit : « Ce garçon
n'est pas un Français. Ce garçon est un juif. » (Au
revoir les enfants, p. 111).
Quand l'histoire de Lacombe Lucien se déroulait, en Juin
1944, les alliés ont débarqué en Normandie. Dès
ce jour, la libération de la France commençait. Il est tragique
que Lucien entre dans la police allemande au moment où la guerre
est presque finie.
Mais la persécution des « collabos » est vraie. (?
Résistance). Seidler écrit :
« Aufgrund von Standgerichtsurteilen
wurden nach dem September 1944 1325 Personen von der Résistance
zu Tode gebracht. In einem Fall genügten 20 Minuten, um 19 Menschen
zum Tode zu verurteilen, und zehn weitere Minuten um sie hinzurichten.
Während der Besatzungszeit hatte die Untergrundorganisation 5000 Kollaborateure
ermordet, den Großteil in den letzten Wochen vor der Befreiung »
(Seidler, p. 23)
(À cause des jugements des
cours martiales après le septembre 1944, 1325 personnes étaient
tués par la résistance. Dans un cas, 20 minutes suffisaient
pour condamner 19 hommes à mort, et dix autres minutes pour les
exécuter. Pendant l'époque de l'occupation, la résistance
avait tué 5000 collaborateurs, la majorité pendant les dernières
semaines avant la libération.) 2
Alors, le rôle de la résistance après la guerre est
très suspect. Il est impossible de faire des jugements justes en
20 minutes ! Ça veut dire que la résistance a aussi commis
des injustices - comme les Allemands.
Aussi dans Au revoir les enfants la résistance commet
une injustice : Le Père Jean renvoie Joseph et impose seulement
une punition symbolique aux élèves.
À mon avis, il est courageux pour un réalisateur populaire
comme Louis Malle de montrer ces sujets dans un film. Mais il lutte aussi
contre l'oubli.
Comparaison de personnages
analogues
Lucien - Joseph
Joseph et Lucien font des travaux inférieurs. Lucien doit nettoyer
les pots à l'hôpital, Joseph aide dans la cuisine et reçoit
des ordres par Mme Perrin.
Les deux avaient été déçus : La mère
de Lucien vit avec un autre homme, dans la maison vivent des étrangers,
même la résistance ne veut pas l'aider.
Joseph est renvoyé, il n'a pas d'avenir. Son amour est fini,
alors il n'a rien à perdre.
En dénoncant des autres, les deux se vengent aux ennemis. Ils
ne font pas cela parce qu'ils sont vraiment collabos, ils ne veulent pas
aider les Allemands. Quand il font la trahison, ils ne peuvent pas retourner.
Joseph parle avec les Allemands s'il est un ami : « C'est un ami
! » (Malle, Au revoir les enfants, p.118), Lucien habite chez
la police allemande.
Quoiqu'il semble que Lucien veut se venger à la résistance,
il ne le veut pas, il dénonce Peyssac par accident. Il voulait seulement
aller en ville à l'hôpital, mais un homme de la police lui
dit d'aller à l'Hôtel des Grottes. Il est fasciné de
cette maison-là (Lacombe Lucien, p.18). Et on lui fait ivre,
il se sent flatté (p.21), alors, il dénonce Peyssac.
Joseph et Lucien voient ses victimes. Lucien ne sait pas ce qu'il a
fait (« Monsieur Peyssac, qu'est-ce que... » (p. 25), il a
de la compassion pour Peyssac.
Mais Joseph est fier. Il dit à Julien « T'en fais pas.
C'est que des juifs... » (Au revoir les enfants, p. 118).
Alors, Louis Malle nous montre deux types différents des dénonciateurs
: Un dénonciateur par accident, l'autre un homme qui veut se venger,
mais tous les deux d'un milieu mal aisé.
Bonnet - Horn
Bonnet est jeune, incapable de se cacher, alors il est caché par
la résistance. Horn est adulte et trouve une possibilité
de se cacher avec sa famille.
Bonnet est intelligent, son père était comptable et il
lit beaucoup, il est toujours gentil.
Jonathan Rosenbaum le décrit comme ça :
« In keeping with the more
"enlightened," liberal brand of French anti-Semitism, which depicts Jews
as cute, lovable, and exotic rather than venal and sinister, the featured
victim is treated as a rare objet d'art rather than an ordinary kid. »
(Conforme à la façon
de l'antisémitisme français, libérale et plus «
éclairée », qui dépeint juifs comme subtils,
aimables et exotiques d'autre part comme des juifs vénaux et sinistres,
le victime présenté est traité comme un objet d'art
rare, pas comme un enfant ordinaire. ) 2
Horn est tailleur, il est artisan, il ne fait pas un travail intellectuel.
Il veut survivre, alors il collabore aussi avec la police parce qu'il taille
pour Jean-Bernard et ses amis et lui donne aussi de l'argent. Mais il ne
veut pas qu'on prenne sa fille. Il dit qu'elle est une « putain »
parce qu'elle va avec Lucien.
Il ne montre pas une attitude religieuse comme Bonnet. Aussi, il est
plus imprudent que Bonnet parce qu'il va en ville et demande à Lucien
s'il peut l'aider à s'enfuir vers l'Espagne (p. 80).
Alors, Louis Malle nous montre deux types différents, mais il
utilise aussi un cliché. C'est le cliché ou préjugé
du juif intelligent. Bonnet est l'enfant parfait.
Mais Horn n'appartient pas au cliché. Il est aussi gentil, bien
sûr, mais il ne symbolise certainement pas l'intelligence française.
Peyssac - Père
Jean
Ils sont tous les deux dans la résistance et aussi professeurs.
Cette ressemblance est frappante.
Louis Malle nous montre peut-être que la résistance était
organisé par des intellectuels. Mais à mon avis, cela provient
du passé de Louis Malle. Il était lui-même dans un
internat catholique où des professeurs étaient dans la résistance.
Un événement comme ça emporte la marque certainement,
alors Louis Malle a choisi un professeur oragnisé dans la résistance.
En effet, Peyssac est moins important que le Père Jean.
Le Père Jean travaille dans la résistance parce qu'il
pense qu'un chrétien doit aider, qu'il ne peut pas laisser faire
les Nazis. C'est pourquoi il dit « Nous sommes entre les mains du
Seigneur. » (Au revoir les enfants, p. 45).
Mais les deux font aussi la même faute : ils révèlent
qu'il sont dans la résistance. Nous ne savons pas pourquoi Joseph
sait que le Père est dans la résistance, mais il le sait.
Il sait que le Père Jean cache des juifs, et Peyssac dit à
Lucien qu'il est dans la résistance. S'ils n'avaient pas dit cela,
ils ne seraient pas été dénoncés.
Le reflet des expériences
de l'auteur
Dans un interview, Louis Malle a dit sur les expériences :
« Le film, dès sa sortie,
était l'objet de violentes discussions. Ses adversaires oubliaient,
ou feignaient d'oublier, que le fascisme a toujours recruté ses
hommes de main dans le «lumpen prolétariat», une loi
historique que Marx et Engels ont été les premiers à
dégager. On me reprochait aussi d'exposer la torpeur, la passivité
des Français sous l'Occupation. Je me suis fait attaquer par un
front commun de gaullistes et d'hommes de gauche pour qui la Résistance
était toute la nation, et le reste une poignée de tarés.
Ils veulent l'Histoire comme elle aurait dû être, et non comme
elle a été.
On me disait: «Pourquoi avez-vous
montré les collaborateurs, et pas les résistants?»
Que pouvais-je répondre? J'avais fait un film sur les traîtres,
pas sur les héros. Dans le détail, si on regarde bien le
film, tout est là, et les différents portraits de gestapistes
étaient une représentation authentique des situations politiques,
économiques, sociales qui ont suscité la collaboration. L'un
d'entre eux était noir, sacrilège! Bien sûr, nous ne
l'avions pas inventé: plusieurs Martiniquais, chômeurs, affamés,
s'étaient retrouvés dans la Gestapo. Pourquoi aurais-je censuré
une information troublante? »
(Louis Malle par Louis Malle, pp.
49-50)
Alors, Louis Malle défend son film. Il dit qu'il a fait un film
sur l'histoire vraie, pas sur l'histoire comme on la veut. Il fait clair
que le film montre des traîtres. Il pense que le film est authentique,
pas changé.
Comme j'ai dit déjà dans le paragraphe « Les Collaborateurs
», ce n'est pas totalement correct, mais il nous montre certainement
un côté importante de l'histoire. Et enfin, il nous montre
que la majorité des Françaises n'était pas héroïque,
et selon Seidler c'est vrai.
Aussi dans Au revoir les enfants, Louis Malle décrit
l'histoire authentique parce qu'il était lui-même le garçon
qui s'appelle Julien Quentin dans le film :
« En 1944, j'avais onze ans
et étais pensionnaire dans un collège catholique près
de Fontainebleau. L'un de mes camarades, arrivé au début
de l'année m'intriguait beaucoup. [...] À travers le regard
de ce petit garçon qui me ressemble, j'ai essayé de retrouver
cette première amitié... »
(L'Avant-scène cinéma
373, p.6)
Conclusion
Finalement, on peut dire que les deux films sont autobiographiques : L'un,
Au
revoir les enfants est autobiographique parce qu'il montre l'enfance
individuel de Louis Malle et l'autre, Lucien Lacombe, est autobiographique
parce qu'il montre le passé de la France, et Louis Malle est Français,
ça veut dire qu'il montre l'histoire vraie de son pays. Il la montre
comme il l'avait vue, pas comme le public veut la voir.
La différence est certainement qu'il n'y a pas modèle
concret pour Lacombe Lucien, c'est un aperçu de toutes les
« Luciens » qu'il y avait. Au revoir les enfants est
une histoire concrète - bien sûr changée à cause
de la mise en scène.
Mais la ressemblance des deux films est absolument claire. Ils montrent
l'Histoire de la France au 20e siècle, les émotions
et les destins de deux personnes de cette époque-là. Il n'y
a pas de description plain des personnages, toujours profonde. Cela transforme
les « types » généraux en « caractères
» individuels, montre que l'histoire se déroule parce qu'elle
est faite par des individus, pas par la masse.
Pour notre époque, les films sont importants parce qu'ils montrent
qu'il y a un petit pas de se joindre à la droite sans le vouloir
par exprès mais par accident. Ce danger est toujours existant, et
il faut le connaître pour devenir immun. Il ne faut pas étouffer
l'histoire.
En réalisant ces films, Louis Malle a fait partie de cette lutte,
et c'est à nous de continuer cette lutte.
Annexe
Remarques
1 La Continental était une entreprise allemande qui produisait
des films français pendant l'occupation
2 Traduction par l'auteur de cette « Facharbeit »
Bibliographie
Jansen, Peter W. u.a., Louis Malle. Reihe Film 34, München
- Wien: Carl Hanser Verlag 1985
Malglaive, Gabriel, Juif ou Français, Editions C.P.R.N.
(o.O.) 1942
Malle, Louis, Au revoir, les enfants, Stuttgart: Verlag Philipp
Reclam Junior 1993
Malle, Louis & Patrick Modiano, Lacombe Lucien, Stuttgart:
Ernst Klett Schulbuchverlag 1989
Malle, Louis, Louis Malle par Louis Malle. Avec le concours de Jacques
Mallecoit, Paris: Editions de l'Athanor, 1979
Seidler, Franz W., Die Kollaboration 1939-1945, München-Berlin:
F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung 1995
Jonathan Rosenbaum, « Au revoir les enfants », en: Chicago
Reader, http://onfilm.chireader.com/MovieCaps/A/AU/00578_AU_REVOIR_LES_ENFANTS.html
Images :
Images 1 et 2: Prises du film « Lacombe Lucien », Nouvelles
Editions de Films (NEF), 1974
Images 3 et 4: Prises du film « Au revoir les enfants »,
Nouvelles Editions de Films, 1988
Image 5 : Prise du livre « Die Kollaboration », de
l'Archive Bilddienst Süddeutscher Verlag
Image 6 : Prise du livre « Die Kollaboration », du
Bundesarchiv de la R.F.A.
Images
 |
 |
| Image 1- Lucien dénonce Peyssac |
Image 2 - Lucien rencontre Peyssac à
la Police |
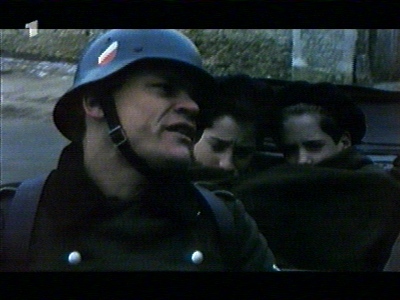 |
 |
| Image 3- Les bavarois ramènent
Julien et Bonnet |
Image 4 - Julien regarde les soldats
qui déportent Bonnet |
 |
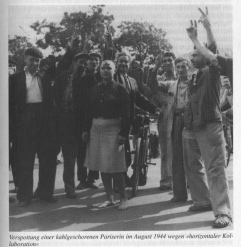 |
| Image 5 - « Membres maltraités
de la milice française devant leurs cellules au Fort Montluc en
chemin à la cour martiale » |
Image 6 - « Moquerie d'une
Parisienne qui a la tête rasée en août 1944 à
cause de la 'collaboration horizontale' » |
Stand: 12.02.2001
© 2001 by Gereon
Schüller, email@gereon.de
Alle Rechte vorbehalten/Tous les droits réservés.
(Certaines fautes grammaticalles et orthographiques ont été
corrigées à l'aide de mon professeur.)
Impressum/Einseigne d'imprimeur